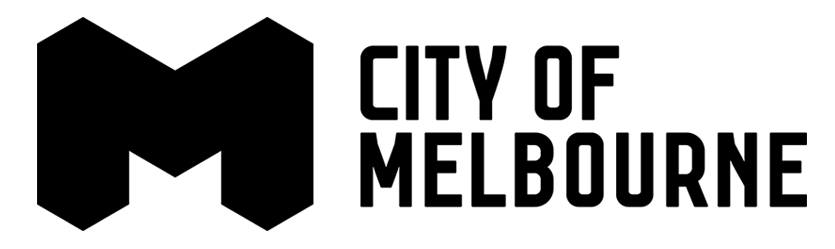Autant Que Possible
I
Soir. De hauts nuages, de la lumière lente : cela ramène en arrière dans l’année ronde. À travers l’heure en reviennent d’autres, aussi bleues. À nouveau, regarder.
Glycine. Retrouver comme croire reprendre en main. Du calme et du bleu bien là pourtant. Du bleu surtout : le calme suit vite quand le bleu est tel, sans aucun vent.
Soir. Sans fin les yeux dans le ciel silencieux. On se dissout dans l’air, dans l’épaisseur cassée poudroyée d’une seule couleur immensément fine et légère, à ciel ouvert.
//
Soir. Carillon. Dehors tient juste entre l’absence de vent, ces cloches, et la lumière. C’est à n’y rien comprendre d’être ainsi entraîné par un jeu de cloches, bougé au point d’entrer reposer dans un bruit habituel et un ciel un soir calme, sans au-delà.
Soir, bien sûr il tombe, et d’une certaine manière les mots, avec. On se presse dans ce qui passe, comme une collecte de dernière minute au ras du sol, un geste qui ramasse quasi rien dans l’herbe, peut-être seulement un peu de calme ou l’odeur de la terre dans l’ombre qui avance.
//
Soir. Peu à voir sauf le ciel et la lumière qui baisse. Se perdre et descendre, chuter lentement dans la couleur trop légère pour porter plus que l’œil. Passer dans la teinte calme, quelque chose d’enrobant léger pas blanc mais déjà plus vraiment bleu. Plus loin, il n’y a rien d’épais mais comme sans fin une suite de voiles bleutées qui bougent. Aucun vertige.
Soir. Le ciel vire lentement et on passe dans l’air sans poids, dans l’espace soudain démesuré du mot ciel. Tout repose et on va comme on dort, sans comprendre quelle clé a tourné. D’évidence, il reste peu de temps : cela va se refermer, il n’y aura plus ni soir ni bleu, juste une vitre sale, la nuit, la lampe.
II
Des mois avec de l’herbe et des arbres : ils passent. Les mots de même : les plus serrés deviennent légers, poreux, friables. Encore un peu d’années, et il n’y aura plus qu’une plage de sable ou un chemin de poussière.
L’œil ne peut s’attarder assez. On voudrait pourtant voir, connaître une fin de l’herbe : il en reste toujours assez pour continuer.
//
est-ce le mot
ou la couleur dans le mot
ou la couleur
quelque chose passe
très lentement déteint
à force de voir
du pâle
quelque chose devenu
comme de la transparence verte
diluée dans la lumière
la couleur
infuse
jusqu’à présent plus rien
mais encore de l’herbe
dans l’œil
III
Le jardin va, le reste aussi, plus ou moins vite, toujours confus. Les mots sont bien moins en avant qu’à la traîne. Des traînes, des lignes.
Temps plat. Animation contenue d’un jour clos. Erre.
Le jardin devient toile tendue, décor devant, vieux paravent à motifs de roses, japonaiserie d’iris. Et dans l’œil s’imposent non plus les fleurs mais de la terre, des tombes pauvres, et la pluie.
Les mots continuent de bouger, on ne sait plus pour qui.
La lumière, elle, vibre encore pour un regard attardé dans l’espace qui s’éteint peu à peu. La tête est déjà dans l’ombre.
Il faudrait peut-être comme une langue de nuit, rapide luisante glissante, des poissons de mots, des rats dans la tête.
IV
Décisive et franche, cette lumière sur la glycine malmenée par l’orage. Ce qui reste à regarder : tiges menues, feuilles hachées par la grêle, fleurs tombées, boue bleue.
_
Au moins, trouver comme un accord avec ce coin de terre le soir malgré les morts, la bêtise et la hargne. Au moins cela et puis se coucher dans l’herbe ou sur les pierres plates, dalles mal roses dans le vert franc, et puis dormir, laisser prendre la fatigue, se figer le sommeil.
//
En face, le toit tranche le ciel. Encore un peu et il n’y aura plus qu’une taille d’ardoise, une dalle de nuit. Bien sûr on peut encore lever l’œil, le faire passer par la bande blanche au ras du toit, entre faîte et ciel plus sombre. Bien sûr, on peut parler parler, durer.
Sur l’antenne, il n’y a plus d’oiseaux.
//
Page sillonnée de noir, et le jardin fond à mesure.
Dans les mots maintenant ,le mouvement d’une terre de nuit, des vagues sombres sur du sable, et aucun vent.
_
C’est toujours tellement à côté.
//
On peut poser un mur, une ombre d’arbre, autant que la mer ou une chaise, une nuit qui n’en finit pas de faire taire le jour, ou des livres, des nuages et des fleurs, des lettres, des enfants, ou une fenêtre qui s’éclaire en face, un dessin naïf laissé sur la table mal rangée avec des feuilles mortes rouges, ou une plage de galets, courte et pentue, au bas d’une falaise… Sans cesse on peut laisser s’égoutter la mémoire d’une seule peau présente et lasse d’être là, attendant que s’éteigne ce qui la retient encore, peut-être des mots, presque plus de désir sinon celui d’une issue, une façon de quitter, cesser.
_
À certains moments, on arrive à tenir immobile, calme et c’est plus facile. On voudrait vraiment alors, durablement, retenir le plus proche – il s’en va malgré, plus loin les choses les mots les êtres, ça fuit jusqu’aux vieilles têtes en terre ou des paysages qui n’existent plus, ou des vues recommencées de panique et de sang. À certains moments, on voudrait pouvoir rester là, border les mots, tirer un rideau lourd juste derrière les choses, au ras. Que plus personne ne touche à rien. Et fermer l’œil.